Les banques centrales à court d’idées
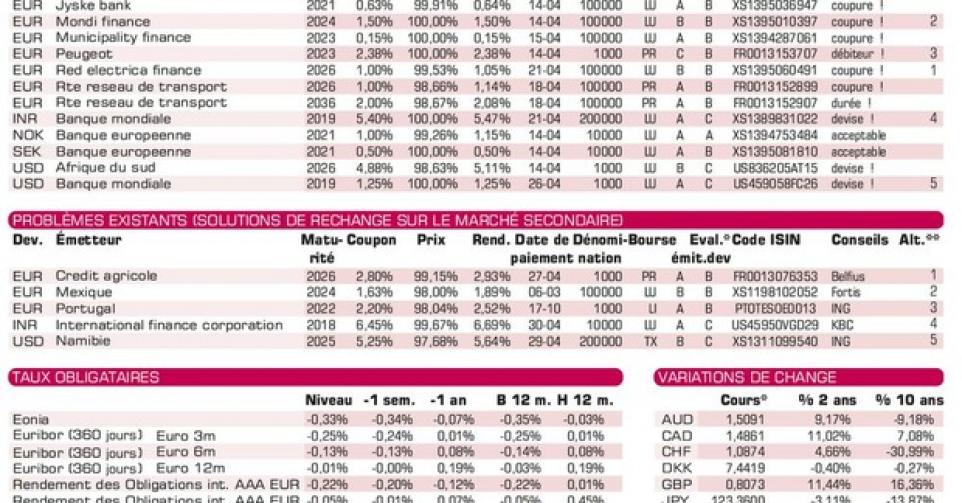
Source: Newsgate
4 min. de lecture
Obligations
Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici




