Le retour des patrons autoritaires
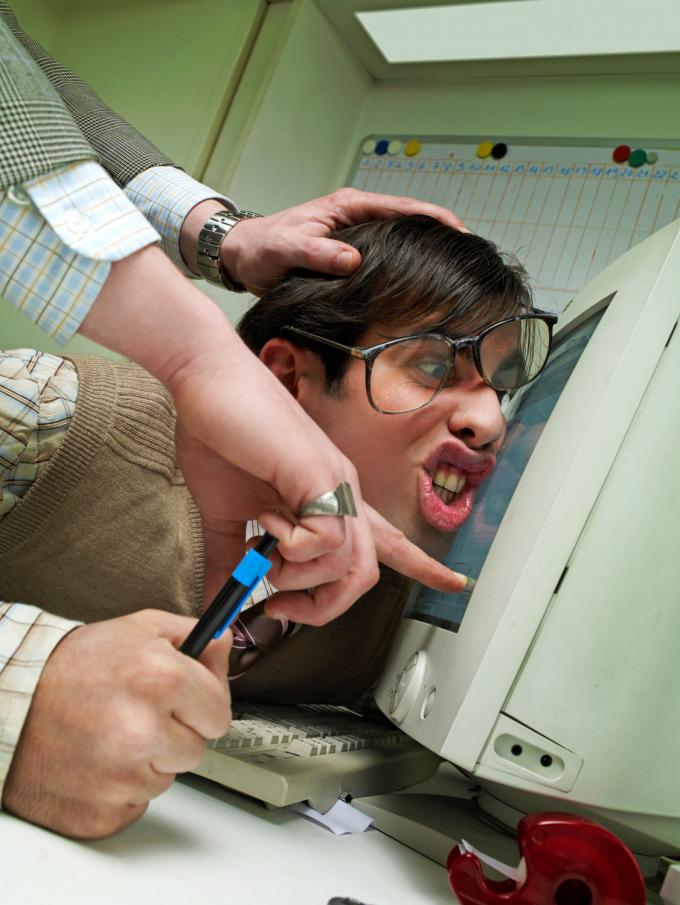

Source: Trends-Tendances
4 min. de lecture
Lire plus de:
Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici