Alors que les leaders de la Silicon Valley affichent désormais leur proximité avec les Républicains à la Maison Blanche, Sébastien Broca, enseignant-chercheur spécialiste du numérique, révèle comment les idéaux libertaires des pionniers d’Internet ont été détournés par les géants du web.
Don’t hurt kids.” Le 25 août, une coalition de 44 procureurs généraux américains a adressé une lettre ouverte à Google, Microsoft, OpenAI, Meta, xAI et consorts, les mettant solennellement en garde contre les graves dégâts psychologiques induits par l’IA.
Alors qu’Internet promettait, à ses débuts, de démocratiser la parole, de libérer les individus et d’encourager leur créativité, force est de constater, 30 ans plus tard, que la technologie a changé de visage. Dans Pris dans la toile. De l’utopie d’Internet au capitalisme numérique, Sébastien Broca, maître de conférences à l’Université Paris 8, explore ce paradoxe central : les idéaux fondateurs d’Internet – ouverture, innovation, émancipation – ont été instrumentalisés par les Big Tech pour asseoir leur domination. Pire, les critiques portant sur la censure, la concentration des monopoles, la collecte massive de données ou l’empreinte écologique ont souvent nourri leur pouvoir.
Très documenté, le livre offre une remise en perspective passionnante des trajectoires de certaines grandes firmes, des idées de leurs fondateurs, mais aussi des législations censées les encadrer.
Tandis qu’Apple et Meta essuient déjà les premières amendes de l’ère du Digital Markets Act (respectivement 500 et 200 millions d’euros) et qu’aux États-Unis, le front judiciaire s’intensifie contre les GAFAM, malgré la proximité de Donald Trump avec certains leaders de la tech, Sébastien Broca invite à repolitiser la question numérique, au-delà de la simple opposition entre innovation et régulation. Car qu’on le veuille ou non, l’IA a cessé d’être une promesse technologique pour devenir un champ de bataille géopolitique et civilisationnel.
Lire aussi| La Big Tech va-t-elle plier sous la pression ?
TRENDS-TENDANCES. Quelles sont les valeurs que recouvre l’utopie d’Internet ?
SÉBASTIEN BROCA. L’idée générale, c’est que les technologies numériques seraient une force d’émancipation, qui contribuerait à éroder des structures sociales, politiques, économiques ou médiatiques, souvent vues comme oppressives. À cette utopie d’Internet se rattachent plusieurs thématiques, comme la liberté d’expression, avec l’idée que les individus ne seront plus seulement des récepteurs d’informations, mais aussi des producteurs, et que tout le monde pourra prendre part au débat public.
Dans les années 1990, on trouve aussi tout un discours sur l’innovation selon lequel Internet devait conduire à une économie plus décentralisée, plus fluide, plus agile. La limite de cette utopie, c’est qu’elle est portée sociologiquement par un groupe assez homogène : des hommes blancs, issus d’un milieu plutôt bourgeois, très éduqués, avec une prédominance d’ingénieurs et d’informaticiens. Quand Internet s’est démocratisé et que d’autres catégories sociales y ont accédé, on s’est aperçu que ce qui fonctionnait dans de petites communautés homogènes – l’auto-organisation, la régulation par les pairs – devenait plus difficile à mettre en œuvre.
Comment les Big Tech ont-ils utilisé la défense de la liberté d’expression aux États-Unis ?
Lorsque les réseaux sociaux commerciaux ont émergé dans les années 2000, ils se sont très vite présentés comme les défenseurs de la liberté d’expression en ligne, censée être garantie par le Premier amendement des États-Unis, historiquement destiné aux individus. Ce positionnement leur a permis d’obtenir une régulation minimale de la sphère publique. Ce discours s’est ensuite étendu aux interfaces techniques, aux logiciels, aux programmes informatiques, avec le slogan “code is speech“. On arrive, par exemple, à l’idée que les pratiques de modération algorithmique chez Facebook relèvent de la liberté d’expression et que l’État n’a pas à intervenir ou à réglementer sur ce que doit faire Facebook dans ses espaces en ligne.
Lire aussi| Les “big tech” veulent-elles vraiment notre bien
Pourquoi estimez-vous que l’IA dite “open source” de Meta relève de l’opportunisme ?
Si les logiciels open source sont depuis longtemps définis sans ambiguïté, l’”IA open source” n’avait, jusqu’à récemment, pas de définition claire. On a donc désigné sous ce vocabulaire des choses assez différentes, allant de projets entièrement ouverts et transparents à des modèles téléchargeables sous certaines conditions, sans aucune information sur les données d’entraînement. Cela a permis à Meta de présenter son modèle Llama comme “open source”, alors même que l’entreprise ne révèle pas les données utilisées.
Cette ouverture partielle, mise en œuvre à partir de 2023, représente alors une stratégie industrielle cohérente, dans un contexte où Meta est légèrement en retard sur ses principaux concurrents du point de vue technologique. Se réclamer de l’”IA open source” procure un bénéfice symbolique en se plaçant du côté de la recherche scientifique ouverte, de la circulation des connaissances, des biens communs. Il y a surtout un bénéfice technologique lié au fait que l’ouverture, même partielle, des technologies stimule la création d’un écosystème d’innovation étendu, qui déborde les frontières de l’entreprise, mais procure à celle-ci des innovations qu’elle peut ensuite librement intégrer à ses produits et services. Enfin, l’”IA open source” joue régulièrement comme un argument pour la déréglementation du secteur.
Comment expliquer l’ambiguïté de la gauche américaine face aux Big Tech ?
Pour moi, il y a une bascule dans la deuxième moitié des années 2010. Traditionnellement, la liberté d’expression était une valeur de gauche. Mais la gauche américaine se rend compte que l’utopie d’un Internet peu régulé ne marche pas: on a des discours de haine, du cyberharcèlement, et les plus vulnérables – notamment les femmes – se retrouvent réduits au silence. Elle réclame donc aux grandes plateformes une régulation plus stricte avec des arguments légitimes, mais en renonçant à l’idéal d’une liberté d’expression maximale.
Cela a ouvert un espace dans lequel la droite s’est engouffrée, en accusant la gauche d’être du côté des censeurs. Ce discours est excessif, mais il a un fond de vérité, parce qu’il existe historiquement une proximité entre la Silicon Valley et le Parti démocrate, surtout sous Obama. La gauche a pu donner le sentiment qu’elle renonçait à une valeur essentielle pour elle. Enfin, l’épisode de la “déplateformisation” de Trump a renforcé ce sentiment : la gauche a unanimement soutenu cette décision, sans voir que cela posait problème de laisser des entreprises privées décider qui a le droit de s’exprimer en ligne, y compris un président en exercice.
“La gauche américaine a soutenu la ‘déplateformisation’ de Trump, sans voir que cela posait problème de laisser des entreprises privées décider qui a le droit de s’exprimer en ligne.”
Au-delà de la régulation au sein des plateformes, pourquoi la législation antitrust, historiquement forte aux États-Unis, a-t-elle été si lente à s’attaquer aux Big Tech ?
Tout tient au retournement doctrinal des années 70-80, associé à Robert Bork et à son ouvrage The Antitrust Paradox. À partir de là, les monopoles n’ont plus été perçus comme des problèmes en soi, tant qu’ils ne faisaient pas monter les prix pour le consommateur. Cette vision est devenue dominante au moment où les Big Tech ont pris le pouvoir. Or, Amazon propose des prix très compétitifs, et Google ou Facebook offrent des services gratuits. Le travail théorique de Lina Khan a été de renverser cette doctrine, en défendant une conception plus structurelle de l’antitrust. Elle a joué un rôle important, d’abord idéologique, en renouvelant la pensée antitrust, puis politique, en menant une action volontariste à la tête de la FTC (Federal Trade Commission ou Commission fédérale du commerce, ndlr) à partir de la présidence Biden.
Justement, l’Europe semble avoir déjà pris le virage de l’antitrust avec le “Digital Markets Act” (DMA) et les enquêtes ouvertes contre Apple, Google et Meta. Ces outils juridiques sont-ils suffisants ?
L’Europe a réagi assez tôt : l’action de Margrethe Vestager à la Commission a précédé celle de Lina Khan aux États-Unis. On peut donc dire que l’Union européenne a ouvert la voie. Mais il y a des limites. La première, c’est l’inefficacité des amendes pour obtenir de vrais changements structurels. Les amendes infligées à Google, par exemple, ont eu un intérêt médiatique et ont permis de publiciser ces enjeux, mais leur effet dissuasif reste faible. Même très élevées, elles sont modestes à l’échelle financière de ces entreprises, payées plusieurs années après les faits, et donc trop tard pour corriger la rupture de concurrence. Les entreprises finissent par les intégrer comme un coût de fonctionnement.

L’exemple de Facebook est parlant : en 2019, après une amende record liée à l’affaire Cambridge Analytica, le cours de l’action a bondi, dès le lendemain, d’un montant supérieur à celui de l’amende.
D’où l’intérêt de nouveaux règlements comme le DMA, qui constitue une véritable avancée. Mais toute la question est leur mise en application et la capacité de l’Union européenne à faire respecter ses propres textes. C’est un enjeu de volonté politique, dans un contexte géopolitique défavorable, alors même que les grandes entreprises de la tech cherchent systématiquement à exploiter les interstices du texte, à obtenir des exceptions ou des régimes de faveur pour s’exempter de leurs obligations.
“Opposer systématiquement régulation et innovation est un discours instrumentalisé par l’industrie pour obtenir le moins de règles possible.”
La volonté régulatoire de l’UE vous parait-elle risquée face à l’avance technologique de la Chine et des USA ?
Opposer systématiquement régulation et innovation est un discours instrumentalisé par l’industrie pour obtenir le moins de règles possible. On entend souvent la formule “les États-Unis innovent, l’Europe régule”, mais elle est trompeuse. Sur le long terme, depuis les années 1990, les régimes réglementaires américain et européen sont assez proches. Aujourd’hui, il est vrai que l’écart s’est creusé : l’Europe a adopté le RGPD, le DMA, le DSA (Digital Services Act, ndlr), tandis que les États-Unis, surtout sous Trump, ont basculé dans une logique de dérégulation. L’histoire montre que l’industrie numérique ne s’est pas développée dans un vide juridique, mais au contraire, grâce à des règles souvent favorables. La régulation peut être habilitante. Ce dont les entreprises ont surtout besoin, c’est de stabilité réglementaire, de la capacité à se projeter dans un cadre clair, plutôt que d’une dérégulation permanente.
Vous relativisez fortement les critiques des repentis de la tech : quels sont, pour vous, les dangers véritables de l’intelligence artificielle ?
Geoffrey Hinton (prix Nobel de physique) a récemment évoqué 10 à 20% de chances que l’IA détruise l’humanité d’ici 30 ans. Mais d’où vient ce chiffre ? Ces discours brassent beaucoup de peurs, avec peu d’éléments factuels accessibles au grand public. Les dangers réels de l’IA me paraissent ailleurs. Elle précarise certaines professions et renforce le pouvoir des Big Tech, qui elles seules disposent des infrastructures de calcul massives nécessaires au développement de ces technologies. Et surtout, elle a un coût environnemental énorme : la multiplication des projets de data centers explose les objectifs de modération énergétique.
Face à cela, l’industrie adopte un discours dilatoire. Éric Schmidt, l’ancien patron de Google, explique par exemple que le coût écologique actuel sera compensé parce que l’IA permettra, à terme, de résoudre le changement climatique. Mais rien aujourd’hui ne permet de le penser. Je ne crois pas réaliste de renoncer à l’IA, mais il faut réfléchir à une “IA frugale”, plus sobre, qui limite son empreinte écologique. Malheureusement, ce n’est pas la voie que suivent aujourd’hui les grandes puissances de l’IA.
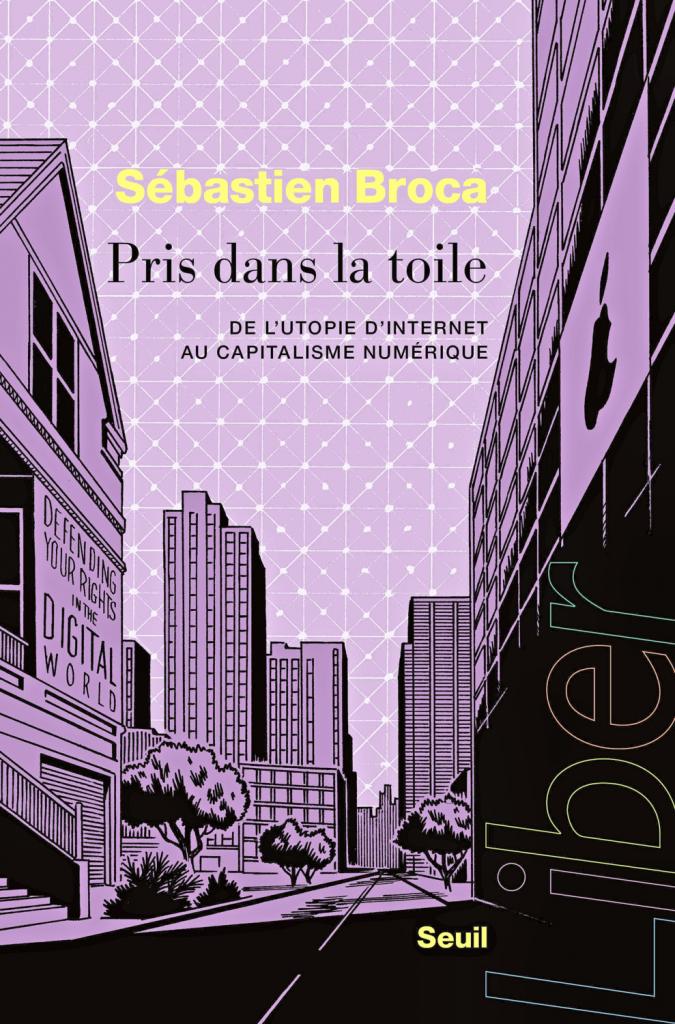
Sébastien Broca, “Pris dans la toile. De l’utopie d’Internet au capitalisme numérique”, éd. du Seuil, 288 P.
PROFIL
• 1983. Naissance à Paris.
• 2013. Publie Utopie du logiciel libre. Du bricolage informatique à la réinvention sociale (éd. Le passager clandestin), qui analyse le logiciel libre en tant que mouvement social.
• 2015. Nommé maître de conférences en sciences de l’information et de la communication à l’Université Paris 8.
• 2025. Publie Pris dans la toile. De l’utopie d’Internet au capitalisme numérique (éd. du Seuil).
Propos recueillis par paloma de Boismorel
Suivez Trends-Tendances sur Facebook, Instagram, LinkedIn et Bluesky pour rester informé(e) des dernières tendances économiques, financières et entrepreneuriales.
