Mariette Darrigrand: “Tout salaire mérite travail!”

Sémiologue et spécialiste du langage médiatique, Mariette Darrigrand dirige Des Faits et des Signes, un cabinet parisien qui conseille les entreprises sur la façon d’articuler leur communication. Chroniqueuse à France Inter et sur France Culture, elle vient de sortir un ouvrage passionnant sur l’origine du mot travail, longtemps associé à la notion de torture en langue latine…
Comme la philosophe Julia de Funès, la sémiologue Mariette Darrigrand appartient à cette caste d’intellectuels français qui portent un regard acéré et juste sur la société d’aujourd’hui. Chargée de cours à l’université Paris 13, elle dissèque, sur France Inter et France Culture, les tendances de notre époque à travers le prisme des mots, parfois justes, parfois utilisés à mauvais escient. Elle dirige, depuis plus de 20 ans, le cabinet Des Faits et des Signes qui, outre une veille médiatique, conseille les entreprises dans leur juste choix de mots pour leur communication.
Mariette Darrigrand est aussi une conférencière recherchée qui aborde, dans les domaines des ressources humaines, des thèmes comme “Les mots contre les maux”, “Les humanités contre la déshumanisation de l’entreprise” ou “Le langage et ses pièges” à destination de managers qui doivent gérer des équipes. Elle vient de sortir un livre épatant appelé L’atelier du tripalium qui réfute la théorie majoritaire depuis le 19e siècle qui soutient que le mot travail vient de torture.
TRENDS-TENDANCES. On l’avoue, nous sommes très intrigués par les services que la sémiologie et qu’un cabinet tel que le vôtre peuvent rendre aux entreprises. Concrètement, que faites-vous ?
MARIETTE DARRIGRAND. Mon cabinet est comme un labo. J’ouvre les mots utilisés et je regarde les métaphores et les images d’origine. Notre esprit parle en fonction de ce qu’il voit ou imagine. Au sens propre comme au figuré. Prenons un exemple. De nos jours, on parle de transition écologique ou climatique. Il faut changer ce discours car nous savons où nous allons. Ce n’est plus une transition mais ce mot nous ramène volontairement à une situation dramatique ou de naufrage.
Concrètement, le cabinet analyse le discours ambiant collectif. Le langage ne porte pas de vérité mais il nous dit comment nous nous racontons la vie collectivement. Les entreprises ont besoin d’être en pointe sur le code commun avant de construire leur discours. Une entreprise qui produit des yaourts doit savoir comment, aujourd’hui, les gens parlent de la santé, de nutrition ou de gastronomie. Il faut qu’elle cale son discours sur les mots tendances, histoire d’avoir un discours cohérent ou une raison d’être qui ait du sens. C’est de la sémiologie appliquée.
Je suis aussi régulièrement appelée pour expliquer et clarifier des mots porteurs de sens comme responsabilité, durabilité, etc. Ce cabinet a pour but de redonner aux mots leurs lettres de noblesse et la force de représenter les choses d’une façon plus positive, plus poétique et, sans doute, plus large.
Les mots sont-ils sciemment dévoyés de nos jours ?
Cela arrive. Ils sont parfois instrumentalisés au nom d’une cause. Prenons le mot retraite dont on a beaucoup parlé en France l’an dernier à l’occasion de cette réforme qui a poussé des centaines de milliers de gens dans les rues. La retraite, contrairement à ce que j’ai lu ou entendu, ce n’est pas l’article de la mort et cela n’envoie pas plus les gens dans l’oisiveté totale d’un seul coup. Il y a beaucoup d’autres sens qui permettent d’ouvrir notre imagination et le champ des possibles. On a eu une vision trop réduite de ce mot et de ce concept en fin de compte. C’est pareil avec le débat sur les sexes et les genres. Soit dit en passant, la sémiologue que je suis n’a jamais cru dans ce “iel” qu’on a fait rentrer au dictionnaire.
“Le langage ne porte pas de vérité mais il nous dit comment nous nous racontons la vie collectivement.”
Dans votre livre, vous démontrez que non, le mot travail ne vient pas de torture. Une théorie erronée qui perdure pourtant depuis des siècles.
Cette théorie veut que ‘travail’ dérive du mot latin tripalium qui désigne un instrument de torture constitué de trois pieux de bois. Cette théorie que l’on trouve dans de très nombreux ouvrages consacrés au management, a émergé au 19e siècle au moment de la révolution industrielle. Sa longévité a évidemment une dimension idéologique simple à comprendre. Cette théorie est tout aussi utile pour expliquer les dysfonctionnements actuels du monde du travail. Mais désolée de décevoir, c’est une immense fake news. Emile Littré, le célèbre lexicographe, n’y a jamais cru mais personne ne l’a écouté.
Cette théorie témoigne d’une vision biblique du travail. Il faut souffrir pour gagner son paradis : tu enfanteras dans la douleur, tu travailleras à la sueur de ton front, etc. La puissance de cette théorie s’exprime toujours dans nos maternités avec leurs salles de travail. C’est très douloureux comme utilisation, non ? Les Allemands sont plus poétiques et parlent de salle de naissance. La version marxiste du travail a le même point de vue que la vision biblique. Karl Marx disait que le travail est une aliénation et que la classe ouvrière devait sortir de ce statut. Son gendre, Paul Lafargue, a commis au 19e siècle un livre intitulé Droit à la paresse. Il y injurie littéralement les ouvriers en disant qu’ils travaillent trop, se font avoir et ont droit à l’oisiveté comme les aristocrates. Le travail est déprécié comme si c’était une horreur pour l’homme.
Il faut sortir de cela tout en n’oubliant évidemment pas que des hommes et des femmes souffrent au travail et que certaines entreprises sont, d’une certaine manière, malades. Ce n’est pas une généralité et il est donc crucial de sortir de ce concept de torture.
Le droit à la paresse de Lafargue, c’est l’équilibre vie privée-vie professionnelle tant recherché aujourd’hui ?
S’il s’agit de relativiser la place du travail dans nos vies, je vous réponds oui. Les jeunes d’aujourd’hui ont vu leurs parents accaparés par le travail et les ont peu fréquentés en fin de compte. Beaucoup en ont souffert. Ils ont aussi constaté que leurs parents pouvaient être virés du jour au lendemain ou souffrir de burn-out. Ils ne veulent pas de cela pour eux et c’est un progrès pour tout le monde. Vous savez, cet équilibre tant recherché nous ramène en réalité à la Rome antique. C’est le negotium face à l’otium. Les activités commerciales profitables face au temps pour soi.
Quel est l’origine du mot travail en fin de compte ?
Travail est, en réalité, un mot très poétique et porteur d’espoir. La véritable étymologie se fait en langue d’oc avec trabalh ou tribalh, un portique dans lequel le cheval est attaché pendant que le maréchal-ferrant le ferre ou lui répare le sabot. Cette machine n’est en rien un instrument de torture mais prouve le soin apporté par l’homme à l’animal et le droit à ce dernier de se reposer.
Ce trabalh/tribahl dérive d’un mot que l’on retrouve, entre autres, chez Virgile : trabs (trabes au pluriel) qui désigne les hautes futaies, le bois haut où l’arbre s’élance vers le ciel. Cela rappelle l’envol et nous ramène à cette quête de sens au travail d’aujourd’hui et ce besoin d’avoir un impact social sur le monde. C’est intéressant d’avoir cela en tête, non ?
“Travail est, en réalité, un mot très poétique et porteur d’espoir.”
Emile Littré avait établi cette bonne étymologie dès le 19e siècle et remarqué l’importance de la matière bois dans le latin. Le français s’est saisi de ce trabs mais pour donner naissance à trave, pièce essentielle d’une charpente. Entrave vient de là aussi. Ce n’était qu’un contre-point de trave mais il est possible qu’elle ait contribué à colorer négativement le verbe travailler qu’en ancien français, on retrouve d’ailleurs sous la forme entravailler.
Il est curieux de constater que les Anglo-Saxons ont, eux, deux mots pour travail : “work” et “labor”.
Labor a la même origine latine que labeur qui a quasi disparu chez nous. Sauf sous sa forme péjorative de laborieux. Labor, dans le monde anglo-saxon, est, au contraire, très positif puisque la Fête du Travail s’y dit Labor Day ! Nous n’avons pas plus développé le work qui vient de l’indo-européen wreg. Ce dernier a donné un temps le mot ‘verser’ en français mais il n’a plus aujourd’hui la moindre connotation de travail, sauf chez les avocats qui versent une pièce au dossier.
Dans les langues, les mots se font la course et travail a tout balayé en français. Cela en dit long sur le poids idéologique qu’il représente vu la théorie fausse qui le sous-tendait. Il est quand même très comique de constater que dans le franglais qui a envahi nos entreprises, jamais on ne dit ‘je worke’. Il m’est arrivé de donner des séminaires dans des entreprises qui voulaient se débarrasser de ce franglais omniprésent. Il est vrai qu’il peut déboucher sur une espèce de dépossession de son identité. Il faut le limiter même si j’adore la langue anglaise que je trouve très poétique et qui a la force de la coalescence absente du français. Un seul exemple que tout le monde connaît : brunch.
Dans votre livre, vous rappelez la célèbre citation de Baudelaire qui disait que le travail est moins ennuyeux que l’amusement. Pas sûr que cela se comprenne bien de nos jours.
Je ne suis pas d’accord. Quand le travail est une passion, quand on exerce le métier de ses rêves, quand on travaille en toute créativité et liberté, cela reste vrai selon moi. Mais cela s’est perdu à cause de la pression de la rentabilité et des objectifs chiffrés, de la mauvaise organisation des entreprises, de la mentalité, bête et méchante, de petit chef de nombreux managers, etc. Cette perte est la source des maux d’aujourd’hui.
Le besoin de réhumaniser le monde du travail, et, c’est un comble vu les mots utilisés, des ressources humaines ramène à cette phrase de Baudelaire. J’y ai beaucoup repensé aussi quand la réforme des retraites a enflammé la France. Beaucoup de Français ont dans la rue exprimé leur souffrance au travail et le besoin de le quitter au plus vite. Pourtant, un retraité se consacre finalement peu à l’amusement et aux loisirs. Il cherche à s’occuper, à se développer, à aider les autres, à se trouver une cause, etc.
La façon dont les gens rouvrent leur vie à la retraite peut être surprenante et tranche singulièrement avec les slogans vus en rue. Nombreux sont ceux qui s’essaient à un autre travail, totalement différent du premier. Ceci dit, j’ai une voisine qui faisait du 7-21 chez Bouygues et qui a passé sa première année de retraite en pyjama. Mais cela n’a pas duré. Nous n’avons pas pour vocation de demeurer contemplatifs.
Nous avons tous toujours bien admis que tout travail mérite salaire. Mais vous, vous prétendez l’inverse…
Tout salaire mérite travail. C’est la phrase du livre dont je suis la plus fière. Elle découle du concept de la vocation. Le travail comme un appel dans la Réforme au 16e siècle. Le christianisme est doloriste, le judaïsme beaucoup moins. Luther et Calvin se sont opposés à cette douleur des chrétiens, à cette souffrance pour gagner son paradis. Ils prétendent que Dieu n’est pas un commerçant et a donné sa grâce gratuitement. Il n’est donc point utile de souffrir pour travailler et gagner quelque chose.
Le travail est, en réalité, la célébration de ce qu’il nous a donné : le talent, les compétences, la vocation, etc. C’est, par ce travail, que nous remercions Dieu de nous avoir sauvés. Luther disait que travailler, c’est prier deux fois. C’est le raisonnement de la Réforme, moment historique où se renverse l’adage bien connu et où l’on se met à penser que oui, tout salaire mérite travail.
Cette démarche a été beaucoup étudiée et travaillée par Max Weber, le sociologue allemand. Au 19e siècle, l’une de ses principales théories politiques parle d’éthique protestante et d’esprit du capitalisme. Il dit, avec raison, que la Réforme explique pourquoi le capitalisme a été porté par les puritains protestants. Travailler pour s’enrichir, c’est normal, c’est rendre grâce à Dieu. Cela n’a rien de honteux. Les conséquences de ce schisme se font encore sentir aujourd’hui et tous les jours.
Ce schisme explique pourquoi tant en Belgique qu’en France, nous n’avons pas de discours positif sur la réussite ? Que nous ne mettons pas nos succès en évidence ?
C’est tout à fait cela. Les pays du Nord et les Anglo-Saxons ont l’esprit protestant. Dans nos pays, le catholicisme a gagné. La France demeure un vieux pays catho. Le sens recherché au travail aujourd’hui chez nous, comme chez vous, c’est la recrudescence des idées de la Réforme. Il faut l’appréhender, cette Réforme, comme un mouvement sociologique de rapport au travail. Il n’est pas doloriste. Les huguenots et les protestants ne le furent pas.
Nous, avec notre tripalium, nous avons consacré cette douleur. Nous n’avons pas ce rapport positif face au travail ou de discours enchanteur sur la réussite. Cela demeure honteux d’être riche. C’est une faute morale. Les riches sont des salauds…
“Il est normal de se poser des questions éthiques sur le partage des richesses mais il faut demeurer positif sur la valeur du travail et ce qu’il permet d’accomplir.”
Mais n’est-ce pas la porte ouverte au populisme et aux extrêmes ?
Oui, il est très dommageable de ne pas célébrer ceux qui réussissent. Il est normal de se poser des questions éthiques sur le partage des richesses mais il faut demeurer positif sur la valeur du travail et ce qu’il permet d’accomplir. Si on ne fait pas cela, vous avez raison, on ouvre la porte à une des bases du populisme : la critique des riches ou la célébration factice de la réussite. Cette célébration factice, c’est Trump. Mais aussi Jordan Bardella (ndlr : président du Rassemblement national) qui est aujourd’hui, aux yeux de beaucoup, l’incarnation parfaite du jeune homme à qui tout réussit.
La réussite fulgurante au masculin, décrite par les sociologues et que l’on trouvait surtout dans le monde du sport ou des start-up, a aujourd’hui un exemple en politique. C’est un modèle, un homme comme ça, quelle que soit sa couleur politique. Il est inspirationnel car vous pouvez adhérer à ce modèle en pensant qu’il n’est pas politique mais psycho-sociologique. C’est inquiétant car il sera peut-être le premier Premier ministre Rassemblement National de France le mois prochain.
C’est dommage que ni les républicains ni les progressistes n’aient un tel modèle de réussite. Les libéraux proposent une version arrogante du travail, la gauche et l’extrême gauche un visage larmoyant de ce même travail.
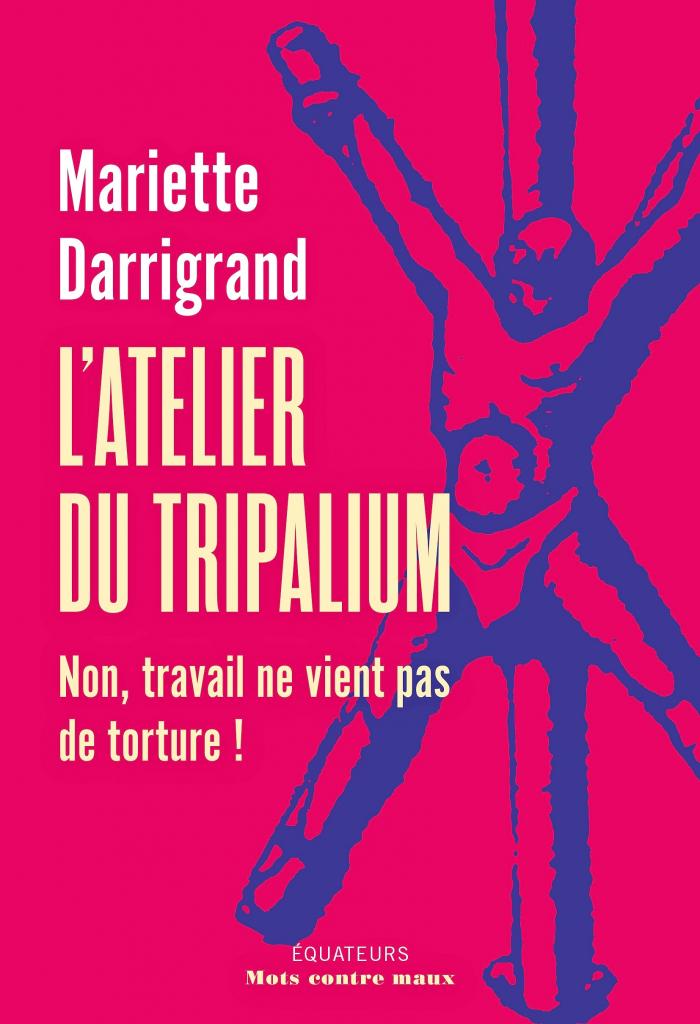
“L’Atelier du tripalium”, 222 pages, Editions des Equateurs, 19 euros.
Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici