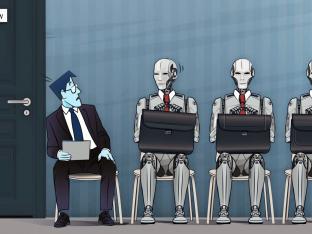Françoise Smets (UCL) : “On sait que l’on n’enseignera plus demain comme on enseigne aujourd’hui”


Vincent Genot
Coordinateur online news
Coordinateur online news
Source: Trends-Tendances
6 min. de lecture
Intelligence artificielle
Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici