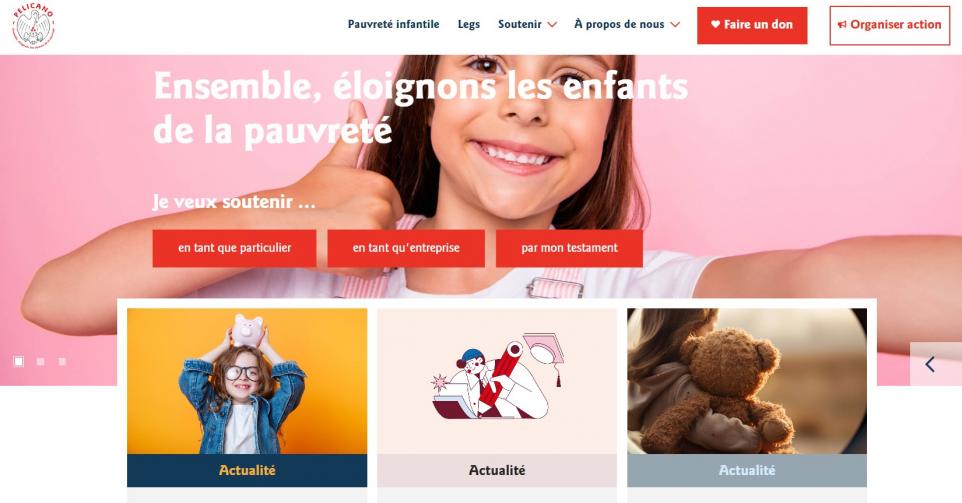La Fondation Pelicano lutte contre la pauvreté en Belgique depuis plus de dix ans. Actuellement, l’inflation, le manque de pouvoir d’achat et l’augmentation des coûts de la vie mettent les familles belges sous pression financière. Les statistiques du Centre d’expertise pour le budget et le bien-être financier indiquent une augmentation de 27,6% du budget alimentaire des familles belges avec jeunes enfants entre 2021 et 2023.
La Fondation Pelicano intervient en sensibilisant, que ce soit par des actions avec des boîtes à tartines, ou en aidant lorsque les factures scolaires s’accumulent. Elle octroie également des bourses pour soutenir les enfants en situation de pauvreté. La triste réalité est que ces enfants sont les principales victimes des difficultés financières des familles belges.
Petit tour d’horizon avec Julien Etienne, administrateur et responsable département social de la Fondation Pelicano.
En quoi consiste plus exactement la Fondation Pelicano ?
La Fondation Pelicano existe depuis un peu plus d’une dizaine d’années. C’est une fondation qui a une double particularité. Premièrement, on travaille sur l’entièreté du territoire belge, ce qui est de moins en moins fréquent. Et deuxièmement, c’est une fondation d’utilité publique, ce qui nous permet de travailler effectivement sur l’ensemble du territoire. L’objectif est d’essayer de lutter de manière la plus durable possible contre la pauvreté infantile, tout en ayant une vision à long terme.
Nous octroyons des bourses à des enfants et à des jeunes qui sont en situation d’extrême pauvreté. Les bourses ne reviennent jamais directement, ni aux enfants ni aux parents. Elles sont toujours confiées à des partenaires sociaux qui sont des professionnels du terrain. Ces derniers connaissent bien les situations et, en collaboration avec le jeune ou avec la famille, ils vont déterminer à quoi la bourse peut être affectée.
Comment s’organise la Fondation Pelicano ?
La Fondation est organisée en deux grands axes : le funding et le social. Le funding c’est la récolte de fonds. Forcément, car nous ne sommes pas subsidiés. Puisque comme on travaille avec des partenaires sociaux, on n’a pas envie d’aller chercher dans leur poche ce qui leur revient pour pouvoir accomplir leur mission.
Et puis le volet social dont je fais partie, en tant que responsable pour tout ce qui concerne la Wallonie : rencontrer les partenaires sociaux, mettre en place différents partenariats. On répond aux questions de nos partenaires, on essaye de les orienter un peu sur la manière de rédiger leurs demandes. Nous faisons aussi partie d’une commission sociale qui se réunit tous les mois et qui va se pencher sur toutes ces demandes. Et statuer si oui ou non on octroie une bourse Pelicano.
Quels sont les besoins des enfants que couvrent les bourses Pelicano ?
On va ainsi couvrir un peu tous les domaines de la vie. Une des spécificités de la fondation c’est que ce n’est pas un one-shot, une fois que la bourse est octroyée, on va jusqu’aux 18 ans de l’enfant. Et parfois même au-delà aussi si, par exemple, il y a un projet d’études ou de mise en autonomie, nous essayons alors de couvrir cette période de transition. Parce qu’on sait, dans tout ce qui est droit, aide à la jeunesse, l’anniversaire des 18, c’est… toujours une rupture assez violente. Je dis toujours : « Les jeunes, le jour de leurs 18 ans, ils passent de responsable de rien à coupable de tout ». Nous essayons donc de couvrir aussi cette période de transition parce que cela serait dommage de mettre quelque chose en place jusqu’aux 18 ans, et puis, parce qu’on a voulu aller trop vite, paf, c’est fini.
C’est vraiment en fonction du besoin : c’est le partenaire social et le jeune qui vont déterminer à quoi cette bourse est destinée. Cela peut être des thérapies spécifiques dont le jeune a besoin et qui ne seraient pas prises en charge. Mais cela peut être tout simplement des repas chauds à l’école, des vêtements. Cela peut aussi être un voyage scolaire. On garde un contrôle sur la dépense, car elle doit être en lien avec un besoin direct du jeune.
Précisons que c’est une bourse annuelle et qu’elle vient après tout ce qui existe déjà. Donc on demande aux partenaires sociaux de faire valoir les droits du jeune (mutuelle, allocations familiales, aide à la jeunesse…) avant d’utiliser la bourse Pelicano.
Vous parlez de partenaires sociaux, qui sont-ils ?
Nous avons environ 500 partenaires sociaux dans toute la Belgique. Principalement en Flandre parce que le projet est une initiative néerlandophone à la base. Pour donner des exemples, on a des écoles et des CPAS. Principalement écoles et CPAS même. Mais on a aussi des ASBL et des institutions. Ce sont les quatre types de partenaires sociaux avec qui nous travaillons principalement. Et ce sont eux qui nous donnent une analyse de la situation budgétaire de l’enfant ainsi qu’un aperçu psycho-médico-social.
A partir de quelle limite estime-t-on qu’une famille est en situation d’extrême pauvreté et pas simplement en difficulté ?
Nous travaillons principalement avec les enfants qui sont vraiment en situation extrême. Parce que des enfants qui sont en situation de pauvreté, malheureusement en Belgique il y en a énormément.
Nous utilisons les chiffres de Statbel, qui sort son rapport tous les ans. Des statistiques sont sorties récemment par rapport aux risques d’extrême pauvreté : on est loin d’être dans l’opulence, le seuil de pauvreté est fixé à 60 % du revenu médian. Donc ce n’est vraiment pas énorme, je crois que c’est 1450 euros par mois pour une personne isolée pour couvrir tous les frais.
Lire aussi| Des micro-dons automatiques pour aider les enfants en difficultés
Comment déterminez-vous ce seuil entre pauvreté et extrême pauvreté ?
Nous nous basons surtout sur les chiffres du SPP Intégration Sociale et de Statbel, qui ont leurs critères très statistiques à eux. À la Fondation Pelicano, nous avons décidé d’être plus souple, en tout cas d’avoir une vision plus au cas par cas des situations. Parce qu’effectivement il y a des situations où on regarde le budget : à la fin du mois il ne reste rien, mais des aides complémentaires ont été mises en œuvre.
Premièrement on va regarder le budget, avec une analyse budgétaire extrêmement complète, cela prend en compte les loyers, les assurances, les dettes éventuelles, etc. Et deuxièmement on va aller regarder tous les éléments psycho-médico-sociaux qui peuvent aggraver la situation. Pour une famille isolée, une situation géographique compliquée d’un point de vue mobilité, un logement insalubre, cela ne se voit pas dans un budget. Mais si les murs sont pleins d’humidité, on sait que cela va engendrer des problèmes de santé, qui vont avoir un impact sur l’école et sur la vie de tous les jours des enfants. Ce sont tous ces éléments-là que nous allons chercher. Je parlais des thérapies spécifiques, nous allons regarder aussi s’il y a un besoin d’accompagnement psychologique parce qu’il s’est passé telle ou telle chose dans la vie du jeune ou dans le contexte familial. Nous regardons aussi, s’il y a un handicap, s’il y a un décrochage scolaire… Ce sont tous des éléments complémentaires qui font qu’on va peut-être prendre plus facilement en charge la situation ou pas. Et la troisième chose qu’on va regarder, ce sont les besoins. Est-ce que les besoins, qui sont liés à la problématique psycho-médico-sociale, sont éventuellement couverts ou pas ?
Nous n’avons pas vraiment de critères financiers. Nous ne disons jamais qu’il faut gagner moins de x euros par mois, car cela dépend vraiment de chaque situation. On a des familles où les parents travaillent, mais ils doivent se lever à 5h du matin pour aller à ce travail, et quand on regarde les solutions de garde, elles ne sont pas énormes… Ou des personnes qui ne savent carrément plus se déplacer pour accompagner leurs enfants à l’école… Donc ce sont ces éléments complémentaires, qui entrent en ligne de compte évidemment.
Quels sont les principaux défis rencontrés par Pelicano dans cette lutte contre la pauvreté infantile?
C’est plutôt en termes de méthodologie, car évidemment la question de la pauvreté infantile est quelque chose qui fait énormément débat. Certaines associations préfèrent ne pas parler de « pauvreté infantile », mais parler de « pauvreté » tout court. Pour ces associations, la pauvreté infantile c’est un élément de pauvreté et qu’en résolvant la question de la pauvreté des parents, on travaille celle des enfants inévitablement. Sauf qu’il y a un tas d’enfants qui n’ont pas de parents, ou dont les parents ne sont pas présents ou qui ne font peut-être pas toujours les choix qu’il faudrait pour leurs enfants… Il y a des enfants qui sont en situation, ce que moi j’appelle des situations « trous administratifs ». Ce sont des enfants qui, en plus d’être en situation difficile, ne rentrent dans aucune case. C’est donc le premier défi, comment réussir à intégrer ces enfants qui n’entrent dans aucune case. Deuxième défi, couvrir les transitions : ne pas abandonner l’enfant à ses 18 ans ou parce qu’il change de commune ou parce qu’il change d’école. Enfin, avoir droit à une continuité dans les politiques sociales et une facilité à pouvoir faire valoir ses droits.
C’est un défi de taille, semble-t-il ?
La complexité administrative est quelque chose qui est énormément dénoncée par toutes les associations et les fondations qui travaillent dans le cadre de la pauvreté. Déjà il faut avoir des compétences pour pouvoir les maîtriser. C’est pour cela que les trois quarts du temps il faut faire appel à des professionnels, des assistants sociaux, voire de plus en plus des juristes. En plus il faut connaître un peu le terrain.
C’est parfois un peu un parcours du combattant où on vous renvoie de service en service, ou alors vers des guichets électroniques. Là on est face à une foire aux questions, mais allez-y pour comprendre les réponses. Même quand on est professionnel de terrain, on ne comprend pas toujours. Donc voilà toute cette complexité procédurière et administrative.
La pédagogie aussi de ce qui est mis à disposition des personnes. Il y a un manque de connaissances, il y a un manque d’informations là-dessus. Donc cela représente un défi supplémentaire.
Et les obstacles que vous rencontrez ?
C’est en lien avec la complexité administrative. Il y a tout cet éclatement de compétences au niveau politique, au niveau régionalisation. C’est difficile de s’y retrouver. Or, énormément de ces compétences ont un lien ou un impact sur les enfants et donc sur la pauvreté infantile. Aussi bien l’enseignement, le logement, la justice, les soins de santé. Là, j’ai cité quatre choses qui sont dans quatre niveaux de compétences différentes. On sent qu’il n’y a pas forcément toujours de coordination ni de logique.
Rien que résoudre cela ou coordonner cela en Belgique, cela pourrait déjà en valoir la peine en matière de défis.
La pauvreté infantile, une fatalité héréditaire ? Comment peut-on changer cela ?
Résoudre la question de la pauvreté infantile, c’est aussi parier sur la génération à venir. On sait que dans le cycle de la pauvreté, il y a un mécanisme de déterminisme social ; c’est-à-dire que les personnes qui sont en situation de pauvreté, les générations suivantes ont, statistiquement, beaucoup plus de chances d’être elles-mêmes en situation de pauvreté. Ces mécanismes sont expliqués depuis des années par les sociologues. En fin de compte, il y a un cercle vicieux qui s’installe.
Le pari que nous avons fait à Pelicano, c’est de se dire que si on intervient financièrement à un moment dans la trajectoire de vie d’un jeune et qu’on débloque un peu de pouvoir d’achat au bénéfice de ce jeune, il pourra éviter certaines carences et donc probablement avoir un peu plus de chances de sortir de cette situation et de lui-même rentrer dans un cercle un peu plus positif. Cela veut dire que ses enfants pourraient probablement être épargnés, ses petits-enfants aussi.
Fin novembre de l’année passée, la Fondation Pelicano plaidait la nécessité d’un renforcement du régime du tiers payant. Où en est-on à ce sujet ?
Alors cela, cela fait partie des choses un peu techniques. En plus, je crois que ce n’est pas tout à fait la même chose au nord et au sud du pays. Je pense que chez les médecins généralistes, c’est acquis, en tout cas pour les enfants en situation de pauvreté, mais il faudrait que je vérifie. Par contre, là où c’est plus inquiétant, c’est par rapport aux spécialistes, qui en plus pratiquent parfois des tarifs variables, selon s’ils consultent à leur cabinet privé ou dans une clinique. Sans compter le temps d’attente pour avoir un rendez-vous.
Ce qui pêche encore, ce sont toutes les thérapies qui sont liées aux difficultés, je ne dirais pas, nouvelles, parce qu’elles étaient déjà là. Sauf que maintenant, la recherche a avancé, on a su mettre le doigt sur plein de choses, comme tout ce qui est troubles DYS, TDAH… Alors, on va me dire, il y a 20 ans, il n’y avait pas tout cela. Si, il y avait, mais on ne le savait pas. On leur disait « adapte-toi, débrouille-toi, et si tu ne le fais pas, tu iras dans l’enseignement spécialisé ou professionnel ». Maintenant qu’on le sait, on ne peut plus passer à côté, et on sait aussi que ces troubles peuvent toucher toutes les couches de la population, et qu’en plus, ils peuvent maintenant être traités. Donc, pourquoi s’en priver ? Pourquoi rester avec une difficulté, alors qu’on sait qu’il peut y avoir des solutions et des accompagnements qui existent ? Pour la prise en charge de ces troubles, il y a encore des progrès à faire.
En cette année électorale, il y a-t-il un de vos enjeux auquel les politiques sont plus sensibles?
C’est un peu difficile comme question parce que comme on a un paysage politique éclaté, mais je sais qu’un des enjeux, c’est la question de la gratuité de l’enseignement. C’est un point sur lequel tout le monde peut s’accorder, même s’il faut encore trouver les moyens, car on le sait : la gratuité de l’enseignement, c’est quand même un coût pour la collectivité. Il faudra donc voir comment, de manière réaliste, réussir à atteindre cet objectif qui pour moi est plus un investissement qu’une dépense. Pourquoi ? Parce que forcément si l’accès à l’école est possible dans de bonnes conditions, dans 15 ans, la société ne s’en portera que mieux, si tout continue à aller bien, évidemment. Donc, c’est une logique d’investissement, mais en attendant, il faut sortir l’argent.
Il y a aussi la question des repas aussi dans les écoles, on voit qu’il y a de plus en plus de pouvoirs politiques locaux, en tant que pouvoirs organisateurs d’écoles, qui essayent de tendre vers la gratuité des repas. Et là, c’est une excellente chose aussi, évidemment.
Finalement, je crois que la question de l’individualisation des droits va être sur la table, parce qu’on en parle vraiment beaucoup.