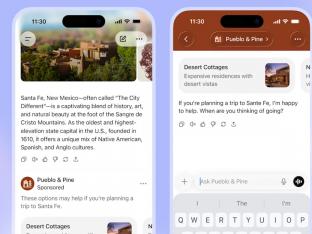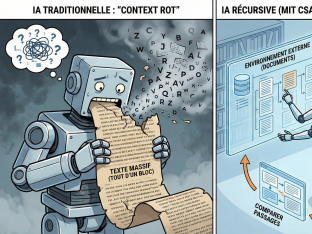GPT-5 devait être l’onde de choc qui fermerait la parenthèse humaine sur les métiers cognitifs. Le soufflé est retombé. Oui, le modèle progresse en fiabilité, en cohérence et en raisonnement mais il ne reproduit pas le saut qualitatif entre GPT-3 et GPT-4. Ce n’est pas un « dieu algorithmique », mais juste un palier.
Cette déception relative change la géopolitique de l’IA. Car en face, les États-Unis ont enclenché l’économie de guerre numérique : des programmes géants de centres de données, des plans à centaines de milliards, des géants californiens qui dépensent un milliard de dollars par jour en R&D et en capacités de calcul. Pendant ce temps, l’Europe végète avec seulement 4 % de la puissance de calcul mondiale, un marché fragmenté, une sur-réglementation qui bride l’ambition et ralentit l’exécution.
Or, précisément parce que GPT-5 n’est pas la singularité promise, une fenêtre s’ouvre. Elle n’est pas immense : 24 à 36 mois, pas plus. Assez pour bâtir des actifs durables : capacités de calcul et bases de données souveraines.
Que faire, vu de Belgique ? D’abord, jouer nos atouts : un pays-plateforme au cœur de l’Europe, avec une logistique de classe mondiale et des talents multilingues. Nous devons mutualiser au niveau Benelux des grappes de puces GPU de rang mondial, et négocier des contrats longs pour sécuriser l’électricité car l’IA ne tourne pas à la bonne conscience, elle tourne aux mégawatts. L’objectif n’est pas de « customiser » des modèles américains, mais d’entraîner des modèles de classe mondiale sur nos corpus : droit continental, normes industrielles, sciences des matériaux, médecine et culture. Notre ADN cognitif ne doit plus être mis en open bar aux géants californiens.
Ensuite, bâtissons des bases de données utiles à l’entrainement des IA. Constituons des jeux de données nettoyés, traçables, lisibles juridiquement, ouvrant la voie à des modèles spécialisés (finance, logistique portuaire, chimie, pharmacie, énergie). L’Europe n’a ni les valorisations boursières ni la masse critique américaine, mais elle a la densité industrielle.
Troisièmement, réformons sans nous auto-handicaper. Le RGPD et l’AI Act n’ont pas vocation à devenir notre masochisme compétitif. Il nous faut des bacs à sable réglementaires où l’on évalue le risque ex post avec des garde-fous mesurés, pas des interdictions ex ante qui condamnent l’expérimentation. Les États-Unis ont compris que la hiérarchie des puissances se mesurera en cerveaux, données et mégawatts. Si Bruxelles continue de confondre prudence et abstinence, l’Europe restera spectatrice.
Quatrième chantier, transformer l’éducation. La déception GPT-5 est un répit, pas un réarmement automatique. Deux à trois ans pour reconfigurer l’école, sinon la prochaine génération de modèles effacera les métiers intellectuels intermédiaires plus vite que nos programmes ne changent. En Belgique, cela veut dire intégrer l’IA comme copilote dès le secondaire, basculer l’évaluation vers des tâches complexes en équipe homme-machine, financer la reconversion des enseignants et des filières d’enseignement vers l’ingénierie des agents et l’automatisation de processus. Cessons de former des diplômés pour un marché qui disparaît. Formons des intelligences adaptatives capables de dialoguer avec des systèmes qui les dépasseront souvent.
Enfin, osons une politique industrielle. L’Europe doit mutualiser la puissance de calcul à l’échelle continentale et nouer des alliances capitalistiques offensives pour rattraper l’écart avec les géants américains et chinois. Sans cet effort, nous accepterons de devenir une colonie cognitive. Nous serions les consommateurs d’IA conçues ailleurs, payant une rente perpétuelle aux géants californiens.
GPT-5 ne nous humilie pas. II nous met au défi. La Belgique et l’Europe ont une brève respiration pour passer du commentaire à l’action. La fenêtre est étroite, deux à trois ans tout au plus.