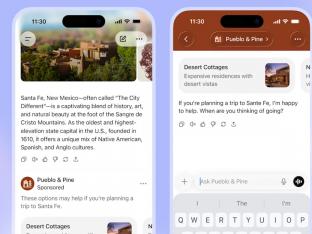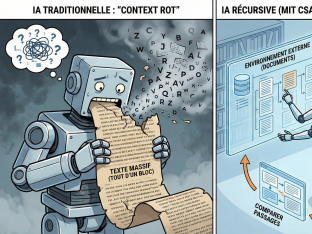Benoît Frénay (UNamur): “Dire que l’IA dépasse l’humain dans la plupart des domaines, c’est faux”


Vincent Genot
Coordinateur online news
Coordinateur online news
Source: Trends-Tendances
7 min. de lecture
Intelligence artificielle
Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici