Start-up: “Arrêtons la mascarade”

Lancer sa start-up est aujourd’hui devenu le nouveau hype du business. L’idée excite une génération entière de jeunes entrepreneurs, poussés dans le dos par des investisseurs et des structures privées et publiques qui y voient le nouvel eldorado. Dans l’ouvrage “Arrêtons la mascarade”, Nicolas Menet et Benjamin Zimmer dénoncent les dérives de l’écosystème start-up et proposent un schéma alternatif.
On ne peut que le constater : l’exposition médiatique des start-up est actuellement inversement proportionnelle à leur poids réel dans l’économie de nos pays. Chaque jour, nos quotidiens et magazines leur réservent une belle place pour exposer leurs réalisations, leurs ambitions, voire leurs paris. Pourtant, si l’on prend le seul cas de la Wallonie, l’écosystème start-up ne représenterait toujours que 3.000 emplois (au mieux) si l’on en croit le baromètre Digital Wallonia 2017. On ne peut évidemment pas dire aujourd’hui que les start-up font figure de poids lourds dans l’activité économique de la Wallonie. Ni même de notre pays. Cette situation n’a par ailleurs rien d’exclusif à la Belgique : ce constat, tous les pays européens sont contraints de le faire. Pourtant, la start-up a le vent en poupe : les structures d’encadrement se multiplient, les jeunes diplômés se rêvent en nouveau Mark Zuckerberg, les investisseurs consacrent toujours plus d’argent pour miser sur quelques jeunes pépites en devenir et les médias placent certaines d’entre elles sur un piédestal. Symbole d’un monde nouveau, la start-up concentre, semble-t-il, tous les espoirs d’une redistribution de la valeur et de l’émergence d’une nouvelle économie, avec de nouveaux codes et de nouveaux acteurs.
Mais les coups de griffes à l’univers start-up (et surtout à ses dérives) commencent à se multiplier. Il y a tout juste un an, dans son livre Bienvenue dans le nouveau monde. Comment j’ai survécu à la coolitude des start-up, la Française Mathilde Ramadier dénonçait la ” mythologie du succès et de l’innovation ” construite sur le succès de ” quelques héros de la Silicon Valley ” et surtout l’exploitation des jeunes travailleurs de l’univers start-up.
La start-up devenue véhicule financier

Depuis peu, un autre livre français, écrit par Nicolas Menet et Benjamin Zimmer, écorne le microcosme des jeunes ” entreprises innovantes ” et plaide pour de profondes modifications pour qu’elles ” contribuent vraiment à l’économie de demain “. Son titre ? Start-up, arrêtons la mascarade. Les auteurs analysent les raisons pour lesquelles la start-up a acquis, aujourd’hui, le statut de sex symbol économique. ” C’est le résultat de trois grands facteurs, nous répond Nicolas Menet, l’un des deux auteurs. D’abord, dans les années 1990, la révolution numérique a fait naître des énormes entreprises au succès économique inédit – les Gafam – qui ont donné à une génération entière des outils digitaux leur permettant de développer des projets. Ensuite, la crise des subprimes et le chaos qui en a résulté ont poussé les capitalistes à chercher des options d’investissements ailleurs qu’en Bourse et en banque. A partir de là, le private equity a pris énormément de place et la start-up est devenue un véhicule financier permettant des placements très rentables. Enfin, l’essoufflement de la croissance dans nos pays matures a poussé les médias à détourner leur regard vers les grandes réussites qui ont fait naître des modèles ‘aspirationnels’ et des figures de proue comme Mark Zuckerberg. C’est sur cette triple évolution qu’est né le mythe de la start-up. ”
Les coups de griffes à l’univers start-up (et surtout à ses dérives) commencent à se multiplier.
Et les auteurs ne sont pas tendres avec la réalité actuelle de l’écosystème des jeunes pousses. Ils dressent le constat que derrière l’utopie et toutes les promesses de ces jeunes entreprises, une autre réalité commence doucement à poindre. D’abord, la majorité des start-up ne vivent pas plus d’un an et rares sont celles qui dépassent les cinq années d’existence. Ensuite, ils épinglent les sommes folles d’argent qui sont distribuées (surtout quand il est public). ” Sans forcément de retour sur investissement et l’emploi industriel est créé en dehors de nos frontières “. De manière plus générale, ” la start-up comme elle est utilisée aujourd’hui est le symptôme d’une société qui va mal et qui ne prépare pas son avenir “. Selon eux, la start-up constituait à la base un acte révolutionnaire pour changer le monde. La volonté des premières start-up, c’est-à-dire les Gafam, ” avait une logique ‘libertarienne’, c’est-à-dire une forme d’anarchisme économique, nous précise Nicolas Menet. Ces entrepreneurs sont sortis des systèmes, des castes et de la finance et ont posé un acte révolutionnaire. Ils voulaient changer le monde “. Mais ils auraient été rattrapés par les schémas traditionnels de la finance. ” On leur a appliqué le modèle d’investissement traditionnel, ce qui a finalement mené à l’industrialisation et à la standardisation des processus, enchaîne Nicolas Menet. Résultat : on fabrique des start-up à la chaîne et des écosystèmes qui ne sont pas assez reliés aux besoins des usagers et aux défis des contemporains. ”
Conditions de travail, bulle immobilière et mauvais projets

L’augmentation constante des montants investis par les investisseurs et structures en tout genre dans les jeunes entreprises pleines de promesses favoriserait cet état de fait. Et les données, compilées fin 2017 par le fonds d’investissement anglais Atomico, tend à leur donner raison : en 2017, les start-up européennes auraient capté quelque 19 milliards d’euros de levées de fonds… contre 14,4 milliards l’année d’avant. ” La mascarade, c’est que ce qui compte aujourd’hui, c’est de lever des fonds et pas forcément de répondre à un besoin, condamnent Nicolas Menet et Benjamin Zimmer dans leur ouvrage. C’est que des investisseurs placent leurs liquidités sans finalement proposer un accompagnement rationnel, c’est que des consultants vendent leurs prestations à prix d’or sans se soucier de leur efficacité, c’est que des incubateurs remplissent leurs mètres carrés, au détriment de la cohérence du projet général. A aucun moment n’est posée collectivement la question : est-ce que tout cela a une utilité, un sens profond et collectif pour faire progresser la société ? ”
Au lieu de cela, on est dans la situation actuelle : un écosystème où, à côté du meilleur, se développe (surtout ? ) le pire : ” dossiers de mauvaise qualité, investisseurs pas toujours au niveau, conditions de travail problématiques, bulle immobilière qui se greffe à la bulle spéculative des investissements, impossibilité de mesurer les actions positives sur l’économie des investissements, notamment publics “. Le propos est illustré dans l’ouvrage par le parcours de Tom, personnage fictif qui représente le jeune entrepreneur classique d’aujourd’hui. On suit la multitude d’erreurs qu’il commet ou qu’on lui fait commettre pour en arriver à fermer sa jeune entreprise un peu plus de deux ans après son lancement. Un classique. Pas si surprenant, alors, que ” les écosystèmes start-up sont insuffisamment structurés et immatures et, en conséquence, font des victimes insoupçonnées : les start-up “.
La page blanche de tous les possibles
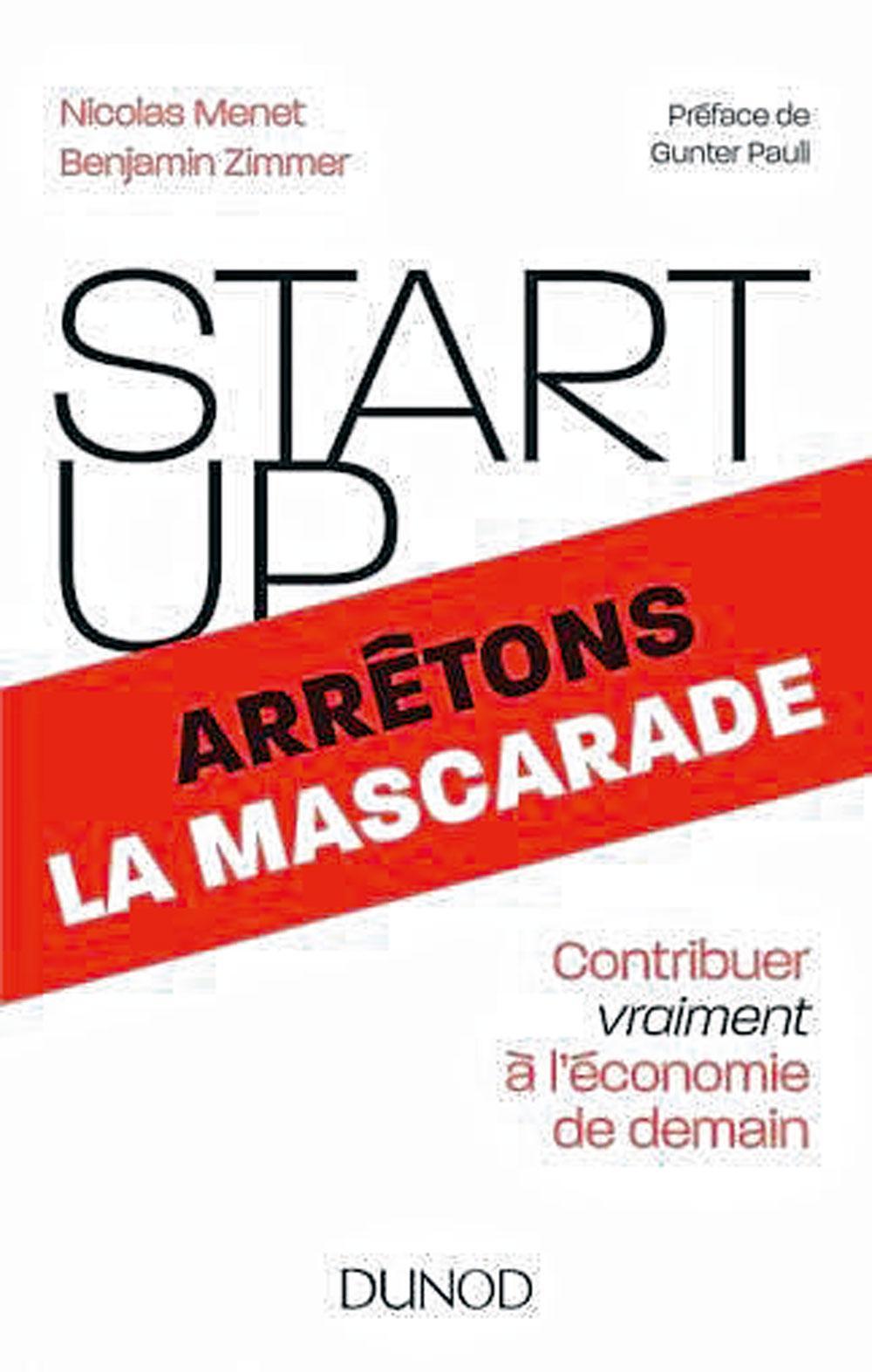
Bien sûr, Nicolas Menet et Benjamin Zimmer, tous les deux impliqués dans l’écosystème des start-up, ne jettent pas le bébé avec l’eau du bain. Pour eux, la start-up constitue bel et bien ” la page blanche qui permettra d’écrire l’histoire économique, sociale et environnementale de demain. Les start-up contiennent dans leur ADN tous les leviers du changement “. C’est bien toute l’ambiguïté de l’écosystème que l’on peut percevoir en lisant Arrêtons la mascarade. Les auteurs commencent par dresser un état des lieux plutôt sombre, visiblement le résultat de multiples occasions manquées, selon eux. Rattrapée par l’univers financier, la start-up aurait dévié de sa trajectoire initiale. Mais son concept n’est pas pourri pour autant. Et quand on les interroge sur le développement, à Paris, d’une structure comme Station F, plus gros incubateur de l’univers start-up financé par le magnat des télécoms Xavier Niel, Nicolas Menet tempère : ” On ne le critique pas, c’est un entrepreneur qui a créé beaucoup de choses, ce n’est pas juste un capitaliste, mais il y a une marge de progression. Il représente l’ancien monde mais pas la mascarade : on a envie de le pousser à faire encore mieux et à ajouter des dimensions plus sociétales et environnementales à son approche “. Car l’état des lieux des deux auteurs mène surtout à une proposition concrète. ” Nous ne voulons pas faire un constat qui se limite à un bashing, intervient Benjamin Zimmer. Au contraire, notre livre est un plaidoyer pour l’entrepreneuriat, mais la meilleure espèce d’entrepreneurs, c’est ceux qui vont s’adapter à leur univers. ”
Dans Arrêtons la mascarade, Benjamin Zimmer et Nicolas Menet soutiennent que le marché de la jeune pousse dans son état actuel mène forcément aux dérives qu’on lui connaît. Ils plaident dès lors pour de nouvelles bases, un ” nouveau monde “. Pour cela, les deux auteurs développent le concept de ” profitabilité intégrale ” selon lequel les start-up peuvent ” revêtir une composante sociale et solidaire, s’inscrivant ainsi dans l’économie positive, écrit le duo. Et rien ne les empêche de se positionner sur l’économie circulaire quand elles produisent des biens de consommation ou qu’elles entament une réflexion sur leur consommation d’énergie “. Et ils s’inscrivent de manière assumée sur le créneau de la ” frugalité qui doit l’emporter sur le gaspillage de ressources et la production de déchets raisonnés “. Une utopie proposée en solution à une utopie potentiellement néfaste ? ” Pas du tout, rétorquent Nicolas Menet et Benjamin Zimmer. Il existe plein d’exemples concrets, nous ne prônons pas le monde des bisounours, mais du concret. L’investisseur qui met ses billes dans une start-up qui fait de la profitabilité intégrale en sort largement bénéficiaire “. Au final, le livre ne crucifie pas l’univers start-up, mais l’invite à faire de la start-up un projet de société plutôt qu’un phénomène sociétal… Ce qui a le mérite, à tout le moins, de lancer le débat.
Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici