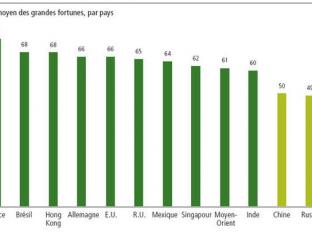Le boom des fondations: portraits de philanthropes

Ils sont richissimes mais à leurs yeux, l’argent n’est pas une fin en soi. Alors ils donnent…
“Nous sommes de plus en plus souvent consultés par des personnes qui, à l’automne de leur vie, veulent structurer une noble et louable initiative qui leur survivra sur le long terme, résume Pierre Nicaise, l’ancien président de la Fédération royale du notariat belge (FRNB). La constitution d’une fondation est souvent la réponse juridique à donner à ce souhait.”
Plutôt que de solliciter leurs maris Adolphe de Spoelberch et Eugène de Mévius pour renflouer l’affaire dont elles avaient hérité (la Brasserie Artois) début 1900, les soeurs Willems, lointaines descendantes de Sébastien Artois, font appel au professeur Léon Verhelst (université de Louvain) pour diriger leur entreprise. Ce dernier le fait avec tant de brio qu’il sera largement récompensé de ses mérites en actions de la société.
Sans succession, Léon Verhelst décide de léguer ses titres à une fondation (créée en 1949) qui porte son nom et dont la vocation est de se soucier du bien-être (de la famille) du personnel de la brasserie et de l’aider en cas de difficultés. La fusion avec Piedboeuf pour former Interbrew d’abord, l’entrée en Bourse ensuite, et le mariage avec les Brésiliens enfin pour donner naissance à InBev, ont dilué la part du fonds Voorzitter Verhelst dans le capital du leader mondial de la bière.
Mais ce dernier est encore aujourd’hui suffisamment riche (près de 7 millions de titres cotés à 76,5 euros soit la bagatelle d’environ 535 millions d’euros !) et rentable (9,5 millions d’euros encaissés en 2012) pour avoir pu étendre son périmètre d’activités à l’ensemble des collaborateurs du groupe à travers le monde !
Toujours au sein d’InBev, le dernier descendant de la famille Baillet-Latour avait lui aussi décidé d’amener ses titres dans une fondation éponyme. Aujourd’hui propriétaire de 0,34 % des titres du groupe brassicole (soit une valeur d’environ 420 millions d’euros sur la base du cours actuel), elle a encaissé l’an dernier des dividendes à hauteur de 6,6 millions et attribué 3,6 millions au (co)financement de projets. Le plus célèbre est le prix Baillet-Latour, d’une valeur de 250 000 euros, qui encourage la recherche fondamentale et la promotion de ses applications en santé humaine…
Pointons encore le cas d’Emile Bernheim, lui aussi sans descendance et qui a pendant des décennies incarné L’Innovation avant de rapprocher son enseigne d’autres grands magasins belges, Le Bon Marché et Priba, puis GB Entreprise pour former GB-Inno-BM (GIB). En 1999, année du décès de son épouse et de l’extinction de l’usufruit en sa faveur, la Fondation Bernheim et la Fondation belge de la vocation héritent de plus de 60 millions d’euros qui leur avaient été transmis.
Emmenée par Françoise Thys-Clement, Robert Tollet et Raymond Vaxelaire, l’équipe qui préside actuellement à sa destinée répartit ses moyens d’actions dans la culture (Musées royaux des Beaux-Arts, Palais des Beaux-Arts, Chapelle musicale Reine Elisabeth), la formation et la recherche-action (bourses de stages, financement de chaires, de l’observatoire de la gouvernance publique, du Musée BELvue…) ou soutient encore l’esprit d’entreprise (Solvay Business School, Start-Academy…). Elle n’a cependant pas échappé à la crise financière de 2008 : 25 % de son patrimoine sont partis en fumée.
L’absence d’héritier direct est loin d’être la première motivation pour se lancer dans la structuration de patrimoines à des fins philanthropiques. C’est le cas de Bernard Majoie, qui s’est enrichi en 2006 en empochant sa quote-part de la revente de l’affaire familiale (les Laboratoires Fournier, 4e groupe pharmaceutique français) à Solvay. Montant du chèque signé à l’époque par le chimiste belge : 1,3 milliard d’euros. “Rester sans rien faire n’est pas dans mon caractère, explique-t-il au Vif/L’Express. J’ai créé une fondation (la Fondation Fournier-Majoie), basée et active en Belgique, en y injectant 20 millions d’euros. L’idée étant d’offrir durablement mon soutien aux chercheurs-trouveurs-entrepreneurs qui ont la volonté de conduire des projets novateurs, susceptibles d’améliorer la santé publique et de favoriser le bien-être.”
Autre famille très impliquée dans les opérations philanthropiques, les Boghossian, qui ont dû fuir l’Arménie, la Syrie et le Liban avant de rejoindre Anvers, en 1975. Bouleversé par le tremblement de terre qui a ravagé l’Arménie en 1988, Jean Boghossian revient pour la première fois dans son pays d’origine. Il sort son chéquier et dépense des millions de dollars. Reconstruction d’écoles, de circuits de distribution d’eau et même d’un parc à Erevan, rien n’était trop beau !
Plus récemment, il s’éprend de la Villa Empain, à Bruxelles. Il la rachète et la fait rénover, ne négligeant aucun détail. “Au travers de l’art, l’ambition de notre famille est de faire de ce magnifique endroit un lieu de dialogue, de rapprochement entre Orient et Occident. Mieux, entre Orient et Orient, à travers l’Occident”, explique-t-il au Vif/L’Express.
Un geste qui a un coût : plusieurs millions d’euros. Chaque année, il doit “remettre au pot”, puisque l’initiative ne s’autofinance pas encore. Philosophe, il relativise : “Donner de mon vivant me permet de voir où va – et à quoi sert – mon argent. De plus, les projets sont fédérateurs, en ce compris au sein même de la famille. Ce qui est plus noble que les seules questions d’argent et de business. Je suis évidemment bien conscient d’agir en dehors des sentiers battus, où trop souvent l’objectif est d’accumuler le plus d’argent possible. J’ai eu la chance de beaucoup recevoir de la société, à mon tour de le lui rendre.”
Par Jean-Marc Damry
>>> Retrouvez le dossier complet dans le Vif/L’Express de cette semaine
Gestion de fortune
Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici